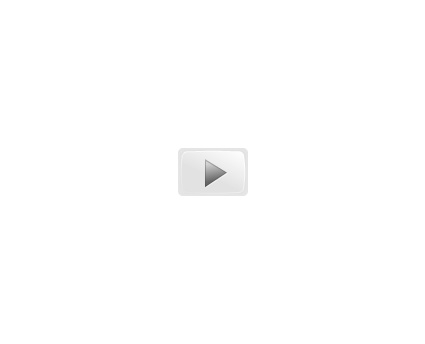Divers professionnels
Les distinctions entre les diff érents acteurs qui interviennent en cancérologie
sont quelque peu arbitraires et schématiques, mais commodes.
Généralités
nécessaires sur un territoire pour des patients résidant loin d’un centre
spécialisé. C’est la raison pour laquelle la cancérologie a suscité l’organisation
de réseaux de soins auxquels adhérent idéalement, et souvent en pratique,
les divers soignants s’occupant d’un même malade, chez lui, à l’hôpital, dans
une maison de convalescence, éventuellement en urgence. Le dossier médical
personnalisé représente un outil de coordination précieux qui doit être protégé
pour respecter le secret médical et préserver l’intimité et les intérêts du patient.
Même s’ils évoquent un cancer périodiquement et si les tumeurs représentent
une part croissante dans leur activité, la plupart des professionnels de santé ne
voient un cancer que rarement. Cinq à six nouveaux cas sont vus chaque année
en moyenne par un médecin généraliste (plus de 300 000 nouveaux cancers
pour 60 000 omnipraticiens en France), alors qu’il voit pendant le même laps
de temps une centaine de bronchites aiguës et quantité d’hypertensions ou de
diabètes. La prévalence est à peine plus importante : le même médecin a dans sa
clientèle, de 3 000 à 4 000 patients, entre 20 et 30 malades traités pour ou ayant
eu un cancer. Cette rareté est accrue par la variété des tumeurs observées qui
n’ont souvent que peu à voir les unes avec les autres : un cancer des bronches est
bien diff érent d’un cancer de la prostate, un hépatocarcinome d’une leucémie
aiguë. Outre leur variété proprement dite, les tumeurs malignes sont à l’origine
de circonstances très diverses motivant l’intervention d’un médecin : réalisation
d’un frottis vaginal, sevrage tabagique, commentaires d’un diagnostic qui vient
d’être porté, contrôle de vomissements provoqués par une chimio thérapie, traitement
d’une douleur…
Très minoritaires sont les médecins spécialisés qui ne voient presque que
des malades atteints de tumeurs malignes. Encore la majorité d’entre eux en
voient-ils de toutes sortes. Exceptionnels sont ceux qui sont surspécialisés
comme un oncologue centré sur le cancer du sein (mais un petit cancer du sein
diff ère d’un cancer mammaire métastatique), ou un gastro-entérologue s’occupant
de cancers digestifs. Il en va de même pour d’autres soignants, à l’exception
de ceux qui oeuvrent dans un établissement ou un service spécialisé.
Pour tous, la diversité s’accentue avec la personnalité de chaque patient, qui
donne une tonalité particulière à un même problème, ainsi qu’avec des innovations,
pour explorer ou traiter. Leur multiplication peut donner une impression
d’impuissance croissante : un médecin en fait toujours autant, en valeur
absolue, mais son intervention représente une part décroissante de tout ce qui
peut être fait pour une maladie et un malade donnés, et qui est pris en charge
par plusieurs professionnels. La constitution de réseaux territoriaux, plurithématiques
mieux que simplement cancérologiques, cherche à remédier à de
telles diffi cultés, mais leur organisation donne à chaque intervenant l’impression
qu’il ne représente qu’un petit soldat noyé dans un vaste bataillon.
Cette diversité est facteur d’attraction autant que source de complications.
Apprendre à des étudiants des détails de prise en charge ne leur sera pas très
utile face au malade qu’ils verront des années plus tard, alors que les moyens
utilisés se sont modifi és, même si ces nouveaux moyens sont accueillis avec
circonspection. Le temps fait aussi évoluer les relations avec les patients. On
ne parle pas à un malade atteint de cancer comme on le faisait il y a vingt ans.
On n’a pas non plus le même type de relation avec lui au long de son cursus
pathologique, du moment où l’on soupçonne le diagnostic à celui où le malade
achève sa carrière, selon la durée de l’évolution, ou bien selon qu’elle s’est faite
d’un seul tenant ou que le cancer initial a été guéri.
Rareté et diversité alimentent les diffi cultés. On fait plus facilement ce que
l’on fait tous les jours, on se rode vite pour surmonter les problèmes quotidiens,
alors qu’on peut être surpris par une question rencontrée des années auparavant
et dont on a oublié la solution.
Quelques exemples
Les médecins généralistes (spécialistes en médecine générale) sont les plus à
même de voir le malade dans son ensemble, dans son environnement familial,
dans son milieu de vie. À proximité, ils sont les mieux placés pour juger de
la possibilité de rester à domicile – en organisant éventuellement une hospitalisation
à domicile, qui n’est possible qu’avec leur accord – ou de la néces
sité d’une hospitalisation classique. Le conjoint du malade a parfois davantage
besoin d’aide psychologique que le patient lui-même. Lorsque nous les avons
interrogés sur les diffi cultés qu’ils rencontrent avec ces malades, les problèmes
psychologiques ont été déclarés nettement plus prégnants que les questions
proprement médicales. Seules les atteintes psychiatriques ou en rapport
avec une consommation excessive d’alcool leur posent des problèmes plus
complexes que les tumeurs malignes. Un cancer avéré leur pose des problèmes
de complexité croissante de l’hospitalisation initiale à la période terminale en
passant par le diagnostic (« doute permanent qui ne doit pas tourner à l’obsession »), les complications de chimiothérapies ambulatoires, l’anxiété et la
fatigue des patients, les rechutes. Lorsque nous en avons reçus pour un stage
d’une semaine au centre anticancéreux, ils se sont montrés plus intéressés par
l’abord relationnel des malades que par les traitements spécifi ques des cancers.
Ils sont également sensibles aux conditions de prise en charge hospitalière
qu’ils considèrent avant d’orienter un malade, que ce soit pour des explorations
diagnostiques, le bilan préthérapeutique ou les divers temps du traitement.
Les centres de lutte contre le cancer ne se voient plus reprocher leur
appellation « transparente », qui risquait de révéler à un malade un diagnostic
qu’on cherchait à lui cacher. Au début des années 1980, une enquête nationale
résumait leurs opinions en concluant : « Le centre anticancéreux vient en tête
pour tout ce qui concerne la compétence, l’équipement, le caractère moderne
des installations et des thérapeutiques pluridisciplinaires. La clinique remporte
le meilleur score en ce qui concerne le bien-être moral (possibilité de cacher au
malade qu’il a un cancer, moins angoissant) et matériel du malade, ainsi que
les bons rapports entretenus avec le généraliste. L’hôpital occupe une position
moyenne entre les deux autres structures. Il est d’un assez bon niveau sur le
plan technique, mais est parfois encore moins bien placé que le centre anticancéreux
sur le plan du confort du malade et de la communication avec le généraliste.
» Depuis trente ans, les eff orts faits par les uns et les autres, l’installation
de pôles de référence régionaux, associant en général centre anticancéreux et
coordination de cancérologie du CHU, l’accréditation pour tous ont estompé
les diff érences et amélioré la qualité des soins partout. Beaucoup de médecins
de famille continuent cependant à regretter de ne pas être tenus au courant
assez régulièrement ni assez vite du déroulement et des conclusions d’un séjour
hospitalier. La généralisation des messageries électroniques et des dossiers
informatisés doit remédier à ces carences. L’institution d’infi rmières coordonnatrices
pour les réseaux de soins cherche également à corriger ce défaut en
facilitant les échanges entre les uns et les autres.
Cependant, un généraliste est chaque jour confronté à des questions sur
la prévention (cf. chapitre « Prévention primaire »), ne serait-ce que pour un
sevrage tabagique plus fréquent que naguère, dans lequel il s’implique plus
souvent. En beaucoup de circonstances, il évoque la possibilité d’un cancer,
même minoritaire : devant une tumeur dans le sein, même si elle est plus
souvent bénigne que maligne, du moins avant 50 ans, devant une altération de
l’état général, une fi èvre prolongée, une anémie hypochrome.
Pour les spécialistes, leur implication en cancérologie varie avec leur spécialité
et la fréquence des tumeurs correspondantes, ainsi que par leur mode
d’exercice. Les radiothérapeutes ne traitent pratiquement que des tumeurs
malignes. Beaucoup de chirurgiens sont également concernés par des interventions
curatives ou réparatrices pour des cancers.
Les gastro-entérologues voient les cancers les plus fréquents. Leur pratique
quotidienne comporte la prévention des cancers de l’estomac par l’éradication
d’Helicobacter pylori, le dépistage des polypes et cancers du côlon par coloscopie
longue ou seulement sigmoïdoscopie, le diagnostic diff érentiel ou positif
des diff érentes localisations, la surveillance des malades traités, par endoscopie
ou dosage d’antigène carcino-embryonnaire.
Les phtisiologues qui s’occupaient de tuberculose sont devenus des pneumologues
avec le recul de la tuberculose et la multiplication des cancers bronchiques
dont les traitements médicaux ont atteint un seuil critique, désormais un
peu plus effi caces que toxiques.
Les urologues sont confrontés aux cancers de la prostate, devenus les plus
fréquents des deux sexes depuis l’expansion incontrôlée du dépistage par le
dosage de PSA (prostate specifi c antigen). Quelques-uns, convertis en sexologues,
voient des malades traités qui ont des diffi cultés pour retrouver une activité
sexuelle délaissée pendant la période pathologique et thérapeutique.
Les gynécologues sont plus occupés par le dépistage et la prévention des
cancers du col de l’utérus que par leur traitement. Les gynécologues médicaux
sont surtout impliqués dans le dépistage des cancers du sein, en liaison avec les radiologues.
L’activité des hématologistes est dominée par les cancers des tissus sanguins
et les traitements comme les transfusions ou la correction des troubles de l’hémostase.
Malgré l’extrême rareté des cancers cardiovasculaires, les cardiologues sont
sollicités en raison de la toxicité cardiaque de nombreux médicaments anticancéreux.
Un psychiatre sera consulté pour cancérophobie, où les cancérologues n’ont
presque rien à faire. Beaucoup plus souvent, il interviendra pour des désordres
psychologiques accompagnant un cancer, qui sont fréquents et peuvent
prendre des proportions le justifi ant.
Les anesthésistes sont souvent diff érenciés en algologie et aident au soulagement
de douleurs rebelles à des remèdes simples.
L’individualisation de l’oncogériatrie souligne que, dans un pays développé,
l’âge est désormais le principal facteur pathogène et elle favorise le retour à une
médecine globale.
Les dentistes peuvent suspecter ou faire le diagnostic d’un cancer de la cavité
buccale. Ils sont également appelés à traiter des dentures en mauvais état avant
une chimiothérapie ou une irradiation cervico-céphalique englobant en partie
mâchoires ou glandes salivaires.
Les infi rmières interviennent en toutes sortes d’occasions et de nombreuses
manières pour traiter les cancers, en particulier à l’hôpital, pour des panse
ments, des chimiothérapies ou des traitements non spécifi ques : transfusions,
perfusions de médicaments pour corriger des infections ou des troubles métaboliques.
Elles se déplacent également lors d’hospitalisation à domicile en
liaison avec le médecin de famille.
Les kinésithérapeutes aident à récupérer une meilleure fonction respiratoire
avant une
anesthésie, ou des fonctions motrices après certaines interventions
mutilantes.
Les travailleurs sociaux (socio-éducatifs à l’hôpital, anciennes assistantes
sociales) sont souvent contactés pour régler des questions administratives d’arrêts
de travail ou d’assurances, ou pour aider à résoudre des diffi cultés matérielles
occasionnées par la maladie et la rupture professionnelle qu’elle entraîne.
Les pharmaciens donnent souvent des conseils ou des avis. Ils revendiquent
la reconnaissance offi cielle d’une « opinion thérapeutique » validant leur
fonction menacée par une commercialisation banalisée des médicaments, telle
qu’on l’observe dans plusieurs pays.
Les associations de malades ou la Ligue contre le cancer apportent des
compléments qui se sont diversifi és et répondent à certaines attentes : conférences
publiques, espaces rencontres information (ERI), groupes de paroles,
organisation de réadaptations, soutien à la formation de professionnels…
Pour tous le cancer est omniprésent, illustrant le modèle bio-psycho-social
de la médecine. Les malades rencontrent des diffi cultés organiques et psychologiques,
mais aussi professionnelles, familiales, fi nancières. Le néoplasme est
considéré tantôt comme le produit d’une malchance, plus souvent comme le
résultat d’une conduite préjudiciable à la santé. À ce titre, les cancers peuvent
servir de repoussoir pour inciter à une vie saine. Si ce peut être effi cace pour
encourager un mode de vie favorable, il est douteux que cela contribue à faire
perdre aux cancers une image exagérément morbide. Ils n’ont pas à prendre la
place d’un Père Fouettard dont on menace les enfants. Comme le dit la sagesse
populaire, « accepte le passé, crois au futur, vis le présent
Représentations
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les idées
qu’ils s’en font »1 Quelles que soient ses propres représentations, héritées
de sa jeunesse ou formées pendant ses études, le praticien doit corriger une
image « pipée » et des représentations des cancers qui pénalisent malades et
familles. Spontanément, ces derniers appréhendent la maladie, en sont stigmatisés,
s’en ressentent souvent honteux ou proscrits. Justifi é par l’épidémiologie,
le terme de fl éau a également le sens de calamité et de fatalité, liées à quelque malédiction.
Le praticien interviendra sans trop d’illusions. Mais le « déminage » s’est
bien amorcé et mérite d’être poursuivi. Il faut continuer à rectifi er une image
véhiculée par des représentations sociales qui n’épargnent pas les étudiants, ni
même quelques professionnels chevronnés. Comme d’autres maladies, ce sont
des événements indésirables, compromettant la santé, menaçant l’existence,
contre lesquels les médecins imposent des traitements dont l’agressivité est
proportionnelle à la malignité traitée. Leur réputation – qui attire ou écarte les
étudiants d’un stage de cancérologie – doit être éclatée selon le type de cancer
et la présentation, plus ou moins avancée, de chacun d’entre eux : le singulier
doit laisser la place à un pluriel qui traduit cette diversité.
Ce sont des maladies dégénératives, en grande majorité rançon d’un allongement
de la vie et d’un vieillissement qu’on ne saurait regretter. Quand tuberculose
et cancers étaient exclusifs l’un de l’autre, c’était parce que la phtisie
tuait avant que l’on atteigne l’âge du cancer. En France, plus de la moitié des
tumeurs malignes sont reconnues après 65 ans, âge supérieur à ce qu’était l’espérance
de vie en 1900. Même si l’on adopte la logique du toujours plus, on ne
peut pas regretter d’avoir un cancer à 80 ans faute d’être mort d’autre chose
à 60 ou, pire, d’une maladie infectieuse ou de faim avant 15 ans. Lorsqu’on
reconnaît une leucémie lymphoïde chronique chez une femme de 85 ans, son
âge est un facteur de plus mauvais pronostic vital que sa leucémie.
Ce sont des maladies bio-psycho-sociales : leur retentissement organique
est parfois moins important que leurs conséquences psychologiques ou relationnelles
avec les proches et l’environnement professionnel. Plus que d’autres
aff ections, ce sont des « maladies totales » qui invitent à une approche holistique,
à la fois « physique, mentale et sociale » pour reprendre les adjectifs défi -
nissant la santé pour l’OMS, centrée sur le patient.
Les cancers tuent une fois sur deux. C’est douloureux pour les malades, même
si beaucoup d’entre eux sont arrivés à un âge avancé où le cancer peut être une
façon de mourir plus qu’une cause directe de mort. Ça l’est plus encore pour
les proches qui vont leur survivre. C’est également pénible pour les soignants
qui perdent un patient et qui ressentent, à tort, sa disparition comme un échec.
Cela rappelle aux étudiants en médecine et aux médecins en général que nous
sommes mortels, alors que beaucoup escomptent la toute-puissance de la médecine.
Au sortir d’un stage en service hospitalier de cancérologie, une majorité
d’étudiants se disent impressionnés par le taux élevé d’« échecs » et de morts
de malades, parce que les malades sont hospitalisés à cause de la gravité de
leur état (d’où l’importance de les faire passer en consultation où ils voient une
majorité de patients qui vont plutôt bien, sont éventuellement guéris depuis des
années). Mais il n’est pas mauvais qu’un tel stage leur rappelle que la médecine
ne peut pas tout, qu’un médecin est particulièrement confronté à des limites.
Si, le plus souvent, il s’agit de celles de l’art médical, il y a aussi de vrais échecs.
Ils attirent l’attention sur les risques d’erreurs à éviter ou stimulent pour faire
reculer encore les insuffi sances de la médecine.
Même si de nos jours les nécrologies préfèrent accuser un « cancer
foudroyant » plutôt que la « maladie longue et douloureuse » qui a longtemps
prévalu, les cancers ne tuent pas brutalement. Ils ne « volent pas leur mort »
aux malades, ce que beaucoup de gens appréhendent. On ne leur ment plus,
sans leur imposer une vérité quand ils ne la demandent pas. Les cancers ne
brutalisent pas les proches alors qu’une mort accidentelle, soudaine, les laisse
désemparés. Ils donnent un peu de temps aux futurs endeuillés pour avancer
leur processus de deuil, tout en évitant un deuil prématuré qui isolerait le
malade en fi n de vie. Ils le font parfois avec l’aide du prochain défunt. Sans
éviter peine et tristesse, l’épreuve peut être atténuée sans truquage, sans fausse
honte, dans l’authenticité.
Qualités
À côté d’inconvénients qu’on ne saurait minimiser, les cancers ont également
des qualités qui ne sont pas négligeables.
Les cancers guérissent, un peu plus d’une fois sur deux. Cela contraste avec
la plupart des maladies chroniques qui touchent les populations vivant longtemps,
et qui sont incurables, même si on peut les contrôler avec un traitement
palliatif ; certaines de ces aff ections ne se contrôlent qu’imparfaitement et
temporairement avant de mal fi nir, de tuer. Si l’on avait le choix entre un cancer
de la prostate ou du sein hautement curable et une maladie de Parkinson, que
choisirait-on ?
Ils sont évitables (cf. chapitre « Prévention primaire »), au moins une fois sur
deux quand on compare leur incidence ou leur mortalité dans des populations
exposées et d’autres relativement protégées. Certes, ils augmentent avec la longévité,
mais le vieillissement ne suit pas toujours l’état civil. Ce caractère évitable
ne concerne pas seulement le cancer bronchique, fréquent chez les fumeurs et
presque absent chez les non-fumeurs. Quoiqu’à un bien moindre degré, le cancer
du sein voit également ses risques diminués par une activité physique régulière,
une alimentation équilibrée qui préserve de l’obésité, l’absence de tabagisme et
d’alcoolisme, l’absence ou la limitation d’un traitement hormonal substitutif à
la ménopause, sans parler d’une nombreuse progéniture allaitée, plus diffi cile à
recommander. Cet évitement est possible pour bien d’autres cancers.
Ils ne sont pas contagieux. Les cancéreux n’ont aucune raison d’être considérés
comme des « pestiférés ». On a oublié les dégâts que faisait la tuberculose,
décimant et dissociant les familles, tuant par exemple, dans les années 1920 en
France, autant de gens – 150 000 environ par an – et plus jeunes que les cancers
en 2011, dans un pays moins peuplé qu’aujourd’hui. Mais elle n’a pas reculé
partout et notre pays connaît encore ou à nouveau des maladies contagieuses et
graves qui permettent de ne pas oublier leurs conséquences sociales, exposant à
l’isolement, à la marginalisation, sinon à l’exclusion.
Ils ne sont pas héréditaires, sauf pour une minorité d’entre eux. Même pour
des cancers réputés tels comme les cancers du sein, moins de 10 % d’entre eux
– un sur vingt environ – le sont. Quant aux cancers de l’enfant, où les facteurs
génétiques sont plus infl uents, ils représentent une part infi me de l’ensemble.
Lorsqu’on sait la place que les « tares héréditaires » occupent dans les représentations
collectives, c’est un avantage qui peut préserver de l’appréhension d’appartenir
à de prétendues « familles à cancers », avec les risques qu’on imagine
pour soi ou ses proches.
Ils respectent les fonctions mentales. C’est déterminant pour les malades, qui
souvent témoignent qu’ils préfèrent « être cancéreux que fous ». Ils gardent
leur lucidité, leur pouvoir de discernement, leur faculté d’exprimer leur
volonté. C’est également déterminant pour ceux qui les soignent. S’ils ne sont
pas entravés par des préjugés regrettables, les étudiants s’en rendent compte
rapidement : les malades atteints de cancers sont des personnes avec lesquelles
on peut parler, qui se font comprendre, comprennent ce qu’on leur dit.
Alors, le cancer est-il un fl éau ou bien les cancers sont-ils seulement un
témoin de notre humaine condition, une rançon de l’allongement de notre vie ?
Sont-ils une cause de mort ou la traduction d’un excès désordonné de vie ?